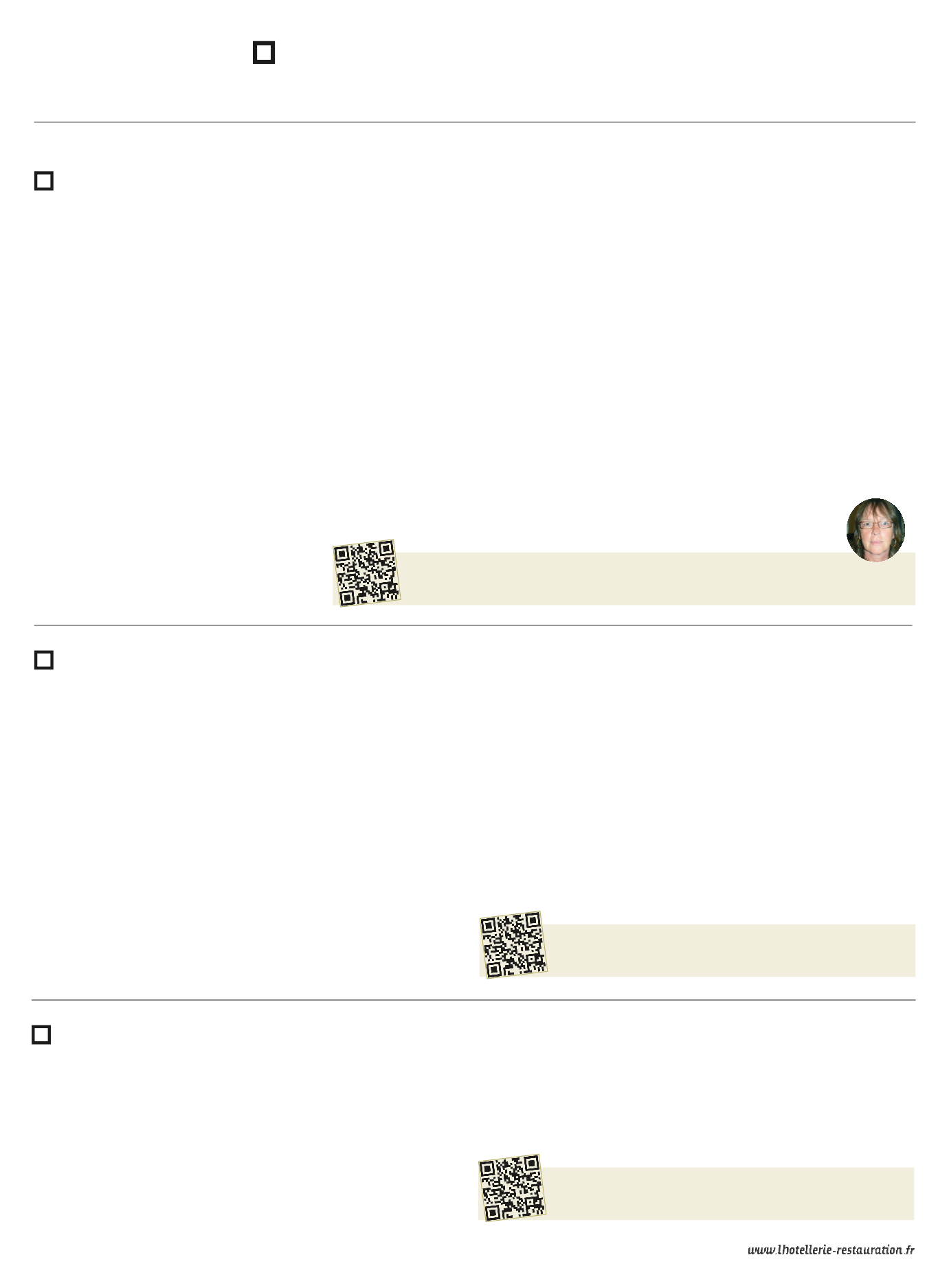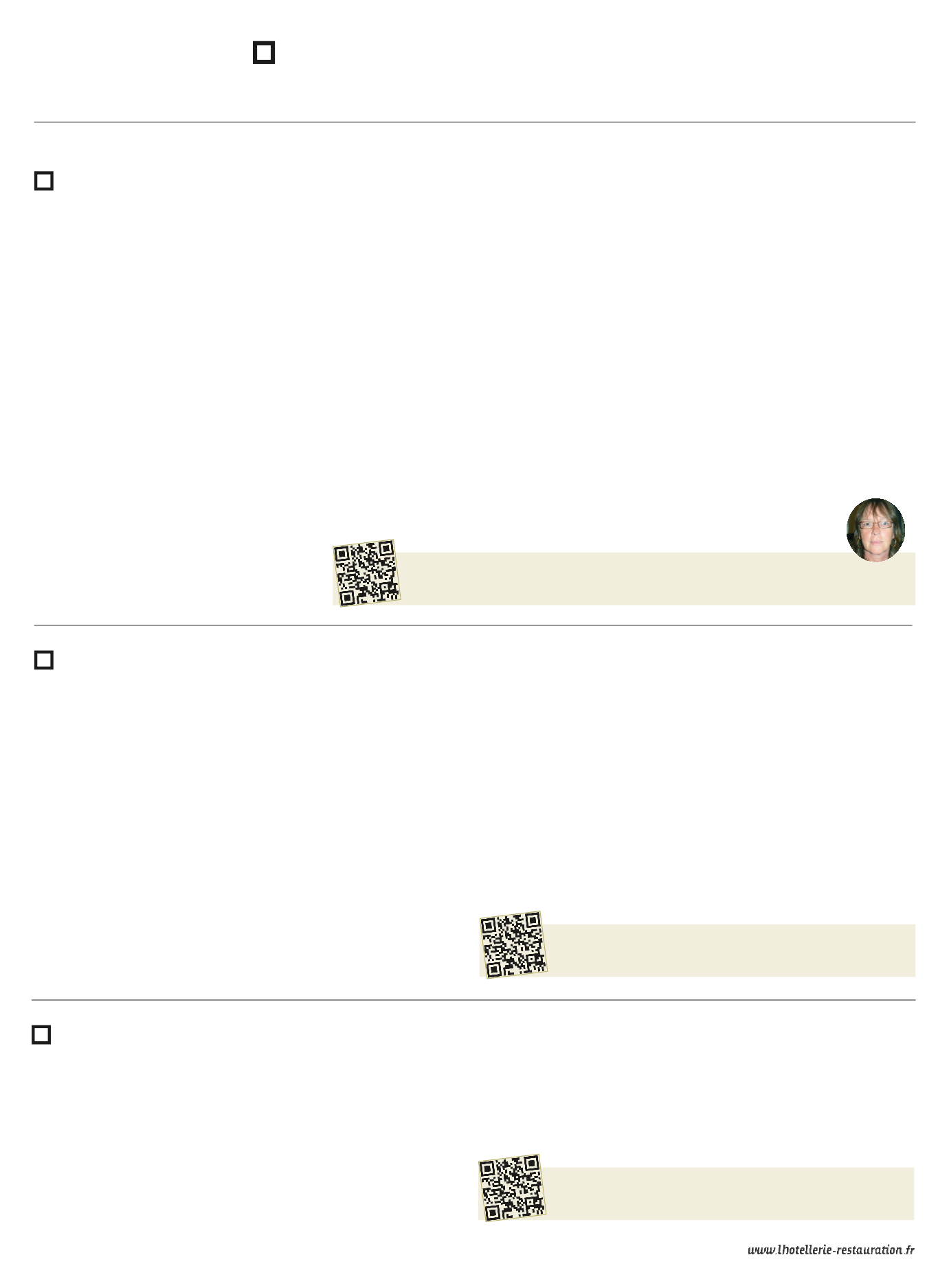
33
6 [MX\MUJZM
Questions-Réponses
Une question ? Rendez-vous sur les Blogs des Experts
sur
Comment accorder les deux jours de
repos hebdomadaire
?
Une question ?
Blog des Experts ‘Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches
de paie)’ sur
Une question ?
Blog des Experts ‘Droit du travail en CHR (+ modèles
de contrats et fiches de paie)’ sur
Mon employé me demande de changer
la répartition de ses jours de repos car
elle n’est pas conforme selon lui. Dans
le planning que j’établis, il est en repos
le mardi et le jeudi en semaine 1, et le
mercredi et le vendredi en semaine 2.
Cet employé ne conteste pas les repos
hebdomadaires non consécutifs mais
leur répartition, qui ne lui convient pas
(travail, repos, travail et de nouveau
repos). Il me demande de travailler au
minimum deux jours, voire trois entre ses
deux repos hebdomadaires. Suis-je en
règle ?
LUCAS
Pour connaître les règles à respecter en matière de
repos hebdomadaire, il faut se reporter à l’article 21
de la convention collective des CHR du 30 avril 1997.
Cet article prévoit que tout salarié bénéficie de deux
jours de repos hebdomadaire en précisant qu’ils
ne sont pas forcément consécutifs et peuvent se
décomposer en un jour et deux demi-journées, non
consécutives.
Ce texte rappelle aussi que si l’employeur donne
un jour de repos isolé, il doit faire attention à ce
que le salarié ait bien droit à un repos de 35 heures
consécutives au minimum entre les deux journées
travaillées, c’est-à-dire 24 heures de repos auxquelles
viennent s’ajouter les 11 heures de repos quotidien.
Par rapport à votre organisation de travail, votre
salarié doit bénéficier de 35 heures consécutives
pour chacun des jours de repos isolés. Concrètement,
votre salarié qui est en repos le mardi doit finir son
service le lundi soir à minuit au plus tard et ne doit
pas reprendre le travail avant 11 heures du matin le
mercredi.
La convention collective prévoit que, dans les
établissements permanents, l’employeur peut
accorder les deux jours de repos hebdomadaire selon
les modalités ci-dessous :
D’une part 1,5 jours consécutifs ou non
- un jour et demi consécutifs ;
- un jour la première semaine et deux jours la semaine
suivante, non obligatoirement consécutifs ;
- un jour dans la semaine et la demi-journée non
consécutive lors de cette même semaine ;
- un jour dans la semaine et la demi-journée cumulable
sans que le cumul puisse être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures
consécutives avec une amplitude maximale de
6 heures.
D’autre part, une demi-journée supplémentaire
Cette demi-journée peut être différée et reportée à
concurrence de deux jours par mois. Là encore, la
demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures
consécutives.
La rédaction un peu compliquée de cet article
s’explique par le fait qu’avant l’entrée en vigueur
de la convention collective nationale des CHR en
avril 1997, les salariés du secteur ne bénéficiaient
que d’un jour et demi de repos par semaine,
conformément à un accord sur le temps de travail
de 1988. Puis la convention a rajouté une demi-
journée pour que les salariés bénéficient de deux
jours de repos par semaine.
PASCALE
CARBILLET
Comment
décompter la période d’essai
d’un CDD ?
Dans le cas d’un contrat saisonnier débutant le 1
er
juillet 2014 et se finissant le 31 août 2014, comment décompter la période
d’essai ? Le législateur stipule un jour par semaine, mais dans ce cas précis et d’une façon générale, faut-il compter 8 ou 9 jours ?
Le 1
er
juillet étant un mardi, celui-ci est-il à décompter ou est-ce le 8
e
jour, soit le mardi 8 juillet ?
F. POMMIER
Un contrat à durée déterminée peut
comporter une période d’essai. Mais
celle-ci doit obligatoirement figurer
dans le contrat de travail pour être
opposable au salarié, et ce contrat de
travail doit être signé par le salarié.
Lorsque le contrat ne comporte pas
de terme précis, la période d’essai
est calculée par rapport à la durée
minimale du contrat.
L’article L.1242- 10 du code du
travail indique que la période d’essai
d’un CDD ne peut être supérieure
à une durée calculée à raison d’un
jour par semaine, dans la limite
de deux semaines lorsque la durée
initialement prévue dans le contrat
est inférieure à 6 mois. Si le CDD est
supérieur à six mois, la période d’essai
peut être d’un mois au maximum.
La jurisprudence précise le mode de
décompte de la période d’essai selon
qu’elle est fixée en jours, semaines ou
mois.
Si la période d’essai est fixée en
jours, elle se décompte en jours
calendaires et non en jours travaillés
(Cass. soc. du 29 juin 2005 n° 02-
45701). Cette jurisprudence a pour
conséquence de réduire le temps de
travail pendant lequel l’employeur
apprécie les compétences de son
salarié. Lorsque la période d’essai
est fixée en semaines ou en mois, elle
se décompte en semaines civiles ou
en mois calendaires, peu importe
le nombre de jours travaillés par le
salarié. Par semaine civile, il faut
entendre toute période de sept jours
consécutifs (Cass. soc. 6 juillet 1994
n° 90-43.877).
Si la jurisprudence précise les
modalités de décompte de cette
période, elle n’en précise pas les
modalités de calcul. Je vous
conseillerais de transposer
ces règles pour le calcul de la période
d’essai. Par conséquent, dans la mesure
où pendant ces deux mois, il n’y a que
8 semaines (ou 8 périodes de 7 jours
consécutifs), vous ne pouvez fixer
qu’une période d’essai de 8 jours, qui
commence le 1
er
juillet pour se terminer
le mardi 8 juillet avant minuit.
Contrat de professionnalisation
à temps partiel
La nouvelle loi concernant la durée minimale de 24 heures par
les contrats à temps partiel s’applique-t-elle dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation ?
F. POMMIER
Il est possible de conclure un contrat de professionnalisation à temps partiel,
dès lors que l’organisation du travail à temps partiel ne fait pas obstacle à
l’acquisition de la qualification visée et qu’elle respecte les conditions propres
au contrat de professionnalisation. La durée de formation doit notamment
représenter 15 à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation,
avec un minimum de 150 heures (Question 1.5.1 de la circulaire DGEFP
n° 2012/15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de
professionnalisation).
La durée du travail fixée dans le contrat inclut les heures de formation. Mais
depuis le 1
er
janvier 2014, le contrat de professionnalisation à temps partiel
doit respecter les nouvelles règles applicables en matière de durée du travail à
temps partiel, c’est-à-dire un minimum de 24 heures. La loi n’a pas prévu de
dérogation pour les contrats de professionnalisation.
Une question ?
Blog des Experts ‘Droit du travail en CHR (+ modèles
de contrats et fiches de paie)’ sur