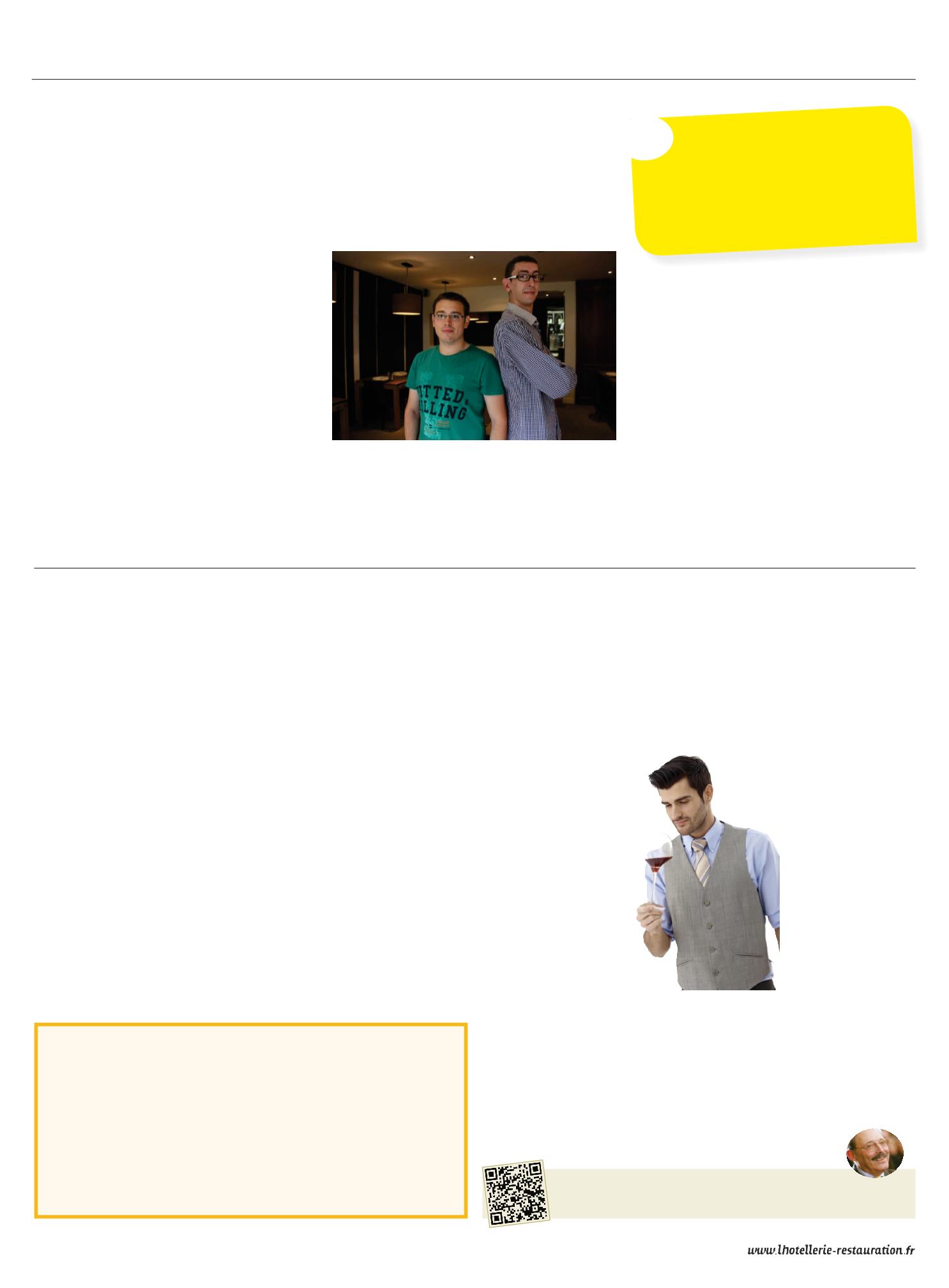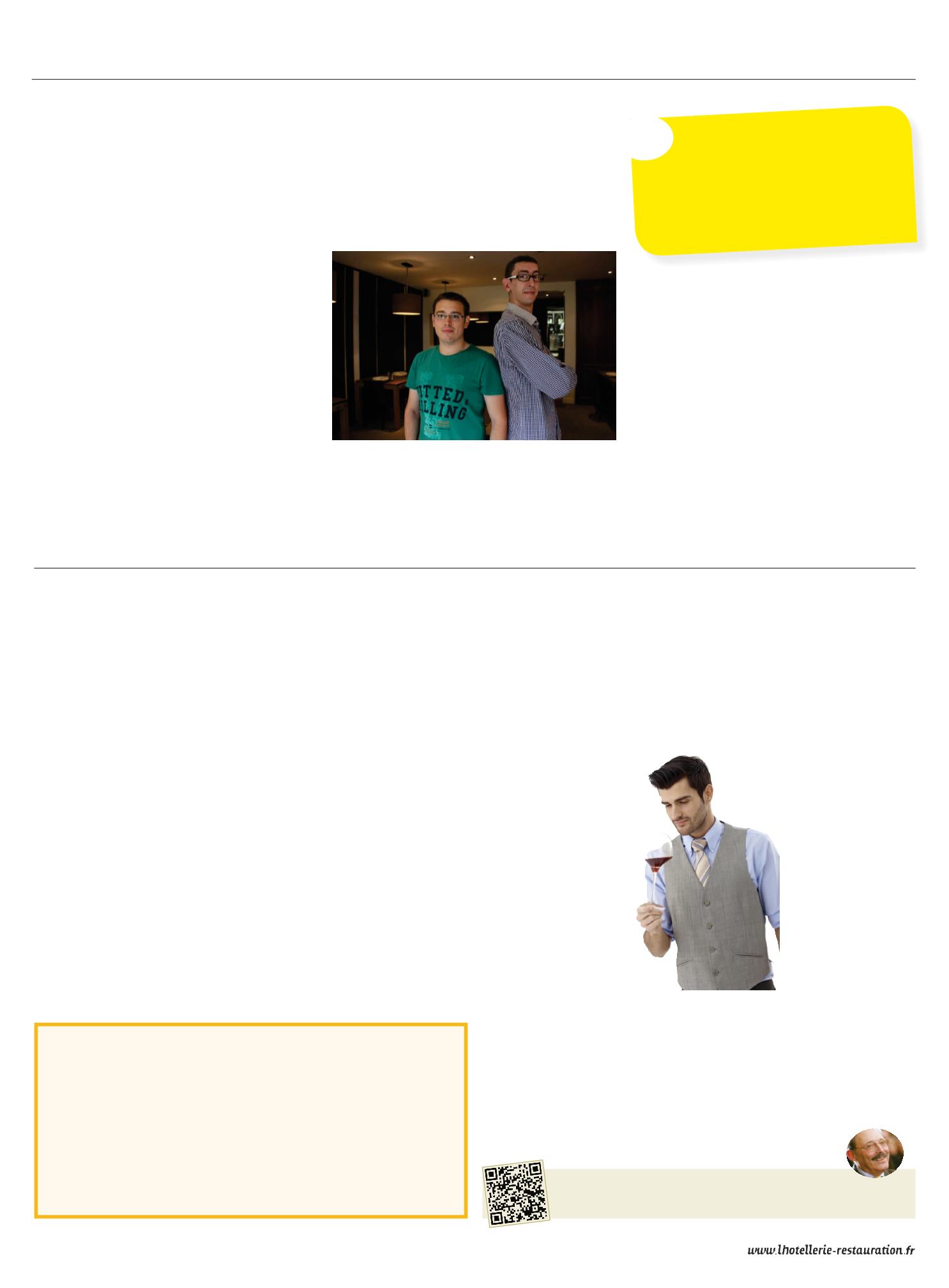
31
6 WK\WJZM
Salle & Sommellerie
Aurélien Ratouit nommé maître d’hôtel du
SaQuaNa
A
urélien Ratouit
a tout juste 27 ans et la curiosité
et la passion pour son métier chevillées au corps.
C’est à lui qu’
Alexandre Bourdas
, le chef étoilé
du SaQuaNa à Honfleur (14), a proposé le poste de
maître d’hôtel de son établissement. Après un bac pro
dans un lycée professionnel de Poitiers (86), Aurélien
Ratouit a enchaîné les saisons, l’été en Bretagne, l’hiver
à la montagne.
“Faire des saisons est très formateur, car
comme vous changez de poste tous les six mois, vous
devez vous remettre en question à chaque fois. Et on
apprend beaucoup.”
Il est arrivé au SaQuaNa il y a un an et demi. Et il se
forme depuis trois mois aux côtés de
FrédéricMorin
,
l’actuel maître d’hôtel, qui quittera l’établissement dans
quelques semaines pour rejoindre celui d’
Anne-Sophie
Pic
à Valence (26). Le poste ? Il reflète la philosophie
de la maison. Chez Alexandre Bourdas, l’organisation
est là mais les codes ont été cassés pour laisser place
à un service décontracté et valoriser la personnalité
de chaque employé. Pas de costume-cravate, les
serveurs sont en chemise et tablier. Tout comme le
maître d’hôtel, qui ne se distingue pas du reste du
personnel.
“Nous avons bien sûr notre organisation
en interne, mais il n’y a pas ce côté hiérarchique
que le client peut voir dans d’autres maisons”,
glisse
Frédéric Morin.
Ambiance vivante et joyeuse
Cette vision des choses convient tout à fait à Aurélien
Ratouit, qui entend bien garder ce qui fait la spécificité
du SaQuaNa : de la belle cuisine dans une ambiance
vivante et joyeuse.
“Je veux bien sûr imprimer ma
marque, mon style, mais je suis encore jeune. J’attends
donc de voir comment vont se dérouler les premiers
mois pour adapter le service à ma vision des choses. Je
veux une équipe qui travaille dans la bonne humeur.
Il faut laisser ses soucis personnels en dehors du
restaurant et se consacrer totalement au client, avec le
sourire.”
À lui donc d’imposer son style, dans la lignée
de Frédéric Morin.
GABRIELLE LEMESTRE
SaQuaNa
ìeì ì40%')ì %1)0-2ìeì
ì 32*0)96
eì 0@ìBì
ì ì ì
ì
ìe
“Pour exercer ce métier, il faut être motivé. Être maître
d’hôtel est une passion. Il faut être très curieux, parler,
se renseigner et ne pas s’enfermer dans des codes. Et
surtout, conserver son naturel. Il faut apprendre dans
les écoles mais ne pas se limiter à cela. Il faut oser, se
lancer. C’est le secret.”
LE CONSEIL DU JOUR
Aurélien Ratouit
s’apprête à reprendre le poste de maître d’hôtel
du SaQuaNa (Honfleur, 14), auparavant tenu par
Frédéric Morin
(à
droite).
HONFLEUR
ì 6(6-'ì 36-2ì7T%4468)ìì59-88)6ì0T8%&0-77)1)28ì4396ì6).3-2(6)ì')09-ì
(T 22)O 34,-)ì -'ìì %0)2')@ì
ì 0ì*361)ì(32'ì732ì79'')77)96ì()49-7ì863-7ì13-7@
Trouver
les bons mots
pour parler du vin
ì 39')6)9<Aì139Aì+26)9<Aì
%786-2+)28@@@ì0)7ì8)61)7ì98-0-77ì
4396ì0%ì(+978%8-32ì(T92)ì
&398)-00)ì328ì()ì593-ì79646)2(6)ì
0)ì234,=8)@ì
D
ifficile à codifier, le vocabulaire
du vin est souvent imagé. Les
termes utilisés en dégustation sont
nombreux. Il est préférable de bien
maîtriser une dizaine de termes, choisis
parmi les plus courants en dégustation,
et de les utiliser à bon escient plutôt que
d’utiliser des mots ou des expressions
qui ne correspondent pas à des
caractères précis. Par exemple : dire d’un
vin qu’il a de la cuisse. Il faut également
éviter les mots passe-partout tels que
gouleyant, terme qui signifie, dans la
langue de Rabelais, ‘qui réjouit la goule’
(la gueule).
Voici deux commentaires succincts de la
dégustation d’un même vin rouge :
a)
Ce vin a une couleur sombre. Il sent
bon, les arômes sont bien perceptibles
au nez. En bouche, il râpe un petit
peu, mais dans le fond ce n’est pas
désagréable.
b)
Ce vin a une robe soutenue, un
nez agréable et une bonne intensité
aromatique. En bouche, on perçoit une
petite pointe d’astringence de bon aloi.
Les deux dégustateurs ont eu les mêmes
perceptions, mais les ont exprimées
différemment. On peut très bien parler
du vin en ne retenant que quelques
termes bien maîtrisés :
En rapport avec
l’alcool
E`^k 3
vin peu alcoolisé.
Corsé
:
vin riche en alcool et en extrait
sec, c’est le contraire d’un vin léger.
Généreux
:
riche en alcool, bien
constitué, qui procure un sentiment de
bien-être, sans monter à la tête.
Capiteux
:
riche en alcool et qui monte
à la tête.
En rapport avec
l’acidité
Mou
:
vin qui manque d’acidité, c’est
un vin plat, sans relief.
Frais
:
peu alcoolisé, bien pourvu en
acidité.
Nerveux
:
vin ayant du caractère,
l’acidité domine.
Vert
:
acidité très marquée, voire
excessive. Le vin est parfois herbacé.
Lors de la présentation d’un vin à un
client, il est préférable de parler de
fraîcheur plutôt que d’acidité.
En rapport avec
la sensation sucrée
Sec
:
pas de perception sucrée à la
dégustation.
Gras
:
onctueux, impression de
douceur.
Doucereux
:
qui manque
d’équilibre, qui possède trop de
sucre par rapport à l’alcool et à
l’acidité.
Moelleux
:
utilisé pour
les vins blancs, désigne
une certaine richesse en
sucre. Ce mot est également
utilisé pour les vins rouges
présentant du gras et une
certaine onctuosité (dans
ce cas, il faut dire que le vin
a du moelleux).
Ebjnhk^nq :
doux, légèrement
sirupeux, souvent capiteux.
La notion de vin sec est très
relative : par exemple, un vin
considéré comme sec en Allemagne
peut être qualifié de doux par des
consommateurs français.
En rapport avec
le tanin
Souple
:
vin peu tannique, agréable à
boire.
Ferme
:
vin où dominent légèrement
l’astringence et l’acidité.
Dur
:
mêmes caractères que le
précédent, mais plus prononcés.
:lmkbg`^gm :
vin ayant un excès
de tanin. Il donne en bouche une
impression de sécheresse. Cette
astringence s’atténue au cours du
vieillissement.
Appréciations globales
Un vin rond est un vin souple
, bien
constitué, légèrement velouté : tanin
et acidité sont bien ‘fondus’.
Un vin équilibré est un vin complet
,
c’est souvent l’apanage des grands
vins.
Deux autres termes
sont souvent utilisés en
dégustation : flaveur et
organoleptique.
?eZo^nk 3
il s’agit d’un
vieux mot qui désigne
l’ensemble du goût et des
odeurs d’une boisson ou
d’un aliment.
Hk`Zghe^imbjn^ 3
terme
créé au siècle dernier
par le chimiste français
Chevreuil
pour qualifier les caractères
perceptibles par les organes des sens.
Il ne faut pas confondre sensoriel et
organoleptique. Sensoriel s’applique aux
organes des sens, organoleptique aux
produits examinés. L’examen sensoriel est
effectué par un individu pour mettre en
évidence les caractères organoleptiques
d’un produit.
En concours, attention au vocabulaire
Lors des épreuves de dégustation dans les concours de sommellerie, l’identification
des vins reste aléatoire. En réalité, elle apporte peu de points. En revanche, l’analyse
sensorielle est primordiale. Mais le candidat ne doit pas se contenter de cette
analyse. Il doit ensuite se prononcer sur la température de service, l’évolution du vin
(à boire ou à conserver) et faire des propositions d’accords vins et mets. Toutes les
dégustations devraient se terminer de cette façon.
Une des erreurs les plus fréquentes, et lourdement sanctionnée, consiste à dire une
chose et son contraire au cours d’une même dégustation :
“Ce vin est très souple
mais les tanins sont encore trop présents”
ou
“c’est un vin frais qui manque un peu
d’acidité”.
Une question ?
Blog des Experts ‘Vins au restaurant’ sur
PAUL
BRUNET
© THINKSTOCK