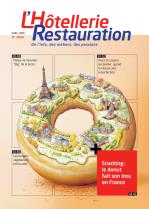Suite à la canicule de l'été 2003, il a été décidé de créer une journée de solidarité pour assurer le financement d'actions en faveur des personnes âgées ou handicapées confrontées à des situations de perte d'autonomie. Cette journée a été mise en place par la loi du 30 juin 2004. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et, pour les employeurs, d'une contribution financière de 0,30 % assise sur la totalité des salaires (article L.3133-7 du code du travail).
La journée de solidarité était fixée initialement le lundi de Pentecôte, sauf pour les entreprises qui travaillaient déjà ce jour férié et pouvaient donc choisir une autre date. Mais la loi Leonetti du 16 avril 2008 est venue assouplir les modalités de mise en oeuvre. Pour le secteur des CHR, cet assouplissement n'a pas apporté de grandes modifications, dans la mesure où une majorité des entreprises travaillaient déjà ce jour-là et avaient par conséquent la possibilité de retenir une autre date.
Qui fixe la journée de solidarité ?
En principe, la journée de solidarité doit être fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par un accord de branche (art. L.3133-8 al.1 du code du travail). Ce n'est qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche que l'employeur fixe librement la journée de solidarité, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cette procédure doit être renouvelée chaque année.
Les derniers avenants conclus dans le secteur - celui du 5 février 2007 et celui du 15 décembre 2009 (soit après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004) - ne mentionnent nullement la journée de solidarité et ne prévoient par conséquent aucune disposition spécifique. Donc, le plus souvent, c'est à l'employeur qu'il appartient de fixer cette journée, dans le respect d'un minimum de règles.
Quelle date retenir ?
L'employeur peut décider que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte - le 9 juin cette année - ou il peut choisir de retenir :
- un autre jour férié qui n'est pas travaillé, à l'exception du 1er Mai, du jour de Noël, du 26 décembre et du vendredi saint (le 18 avril en 2014) qui précède le lundi de Pâques dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ni le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements d'outre-mer (dates différentes selon les départements) ;
- un jour de RTT (réduction du temps de travail) dans les entreprises qui appliquent ce dispositif sous forme de journées de repos ;
- le fractionnement de cette journée, en répartissant les 7 heures correspondantes sur plusieurs jours ou toute autre modalité qui permette le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles.
Elle peut aussi être prise sur l'un des deux jours de repos hebdomadaire, car la loi n'en impose qu'un seul. En revanche, ne peuvent pas être retenus comme journée de solidarité :
- un jour de congé payé légal. L'employeur ne peut imposer la prise d'un jour de congé payé le lundi de Pentecôte si c'est cette date qui a été retenue (Cass. Soc. 15 janvier 2014, n° 11-19974) ;
- un jour de repos compensateur, celui-ci ne pouvant être assimilé à un jour précédemment non travaillé (Circ. DRT du 20 avril 2005).
Dans la mesure où la convention collective des CHR prévoit l'attribution de 4 jours fériés ordinaires en plus du 1er Mai, les employeurs peuvent donc choisir l'un d'entre eux, c'est-à-dire n'accorder que 3 jours fériés ordinaires en plus du 1er Mai. Les employeurs peuvent aussi choisir de l'imputer sur l'un des 6 jours fériés garantis accordés par l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009.
Elle peut différer pour chaque salarié
En principe, la date de la journée de solidarité retenue s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il n'est pas possible de prévoir plusieurs journées de solidarité en fonction des différents services d'une entreprise. Comme pour tout principe, il est prévu des exceptions permettant de retenir une journée de solidarité différente pour chaque salarié de l'entreprise, dans les cas suivants :
- lorsque l'entreprise travaille en continu (24 heures sur 24, sept jours sur sept, dimanches et jours fériés inclus) ;
- lorsque l'entreprise est ouverte tous les jours de l'année ;
- si le salarié ne travaille pas la journée de solidarité en raison de la répartition de ses horaires de travail, et que celle-ci tombe pendant son repos hebdomadaire.
Pas de rémunération
Le travail durant la journée de solidarité n'est pas rémunéré. La loi prévoit que cette neutralité ne joue que dans la limite de 7 heures. Les heures travaillées au-delà doivent être payées. Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat. Par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à trois heures et demie (7 ÷ 2).
Pour les cadres au forfait jours, le travail de la journée de solidarité s'ajoute au nombre de jours fixés par la convention de forfait, sans donner droit à un complément de rémunération. Du fait de l'instauration de cette journée de solidarité, la durée annuelle légale de travail est de 1 607 heures par an. Un plafond que doit respecter la profession en cas de modulation du temps de travail. Quant aux conventions de forfait annuel en jours, le plafond a été fixé à 218 jours. Pour éviter tout problème, il est fortement conseillé aux employeurs de faire apparaître cette journée de solidarité sur la fiche de paie afin d'être en mesure de prouver qu'elle a bien été effectuée.
Une obligation civique
Le Conseil d'État a jugé que cette journée de solidarité ne constitue pas une journée de "travail forcé ou obligatoire" au sens de l'Organisation internationale du travail (OIT). La haute instance a considéré qu'il s'agit d'une obligation civique normale en conformité avec les stipulations des conventions internationales, notamment l'article 4 alinéa 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil d'État 9 novembre 2007 n° 293987).
De même, dans une décision du 22 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a validé le principe de la journée de solidarité en décidant qu'elle respecte bien le principe d'égalité devant la loi. Il avait été appelé à se prononcer sur deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ceux qui contestaient la constitutionnalité de la journée de solidarité invoquaient la rupture du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, avançant l'argument suivant : la journée de solidarité ne s'applique qu'aux salariés et aux fonctionnaires et exclut de son champ d'application les artisans, les commerçants et les professions libérales sans salariés, ainsi que les retraités. Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement avec les retraités et les travailleurs indépendants est "en rapport direct avec l'objet de la loi", et de conclure : "L'instauration de la journée de solidarité n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques." Cependant, depuis le 1er avril 2013, les retraités assujettis à l'impôt sur le revenu doivent eux aussi s'acquitter de cette contribution de solidarité à hauteur de 0,30 % de leur pension.

Publié par Pascale CARBILLET